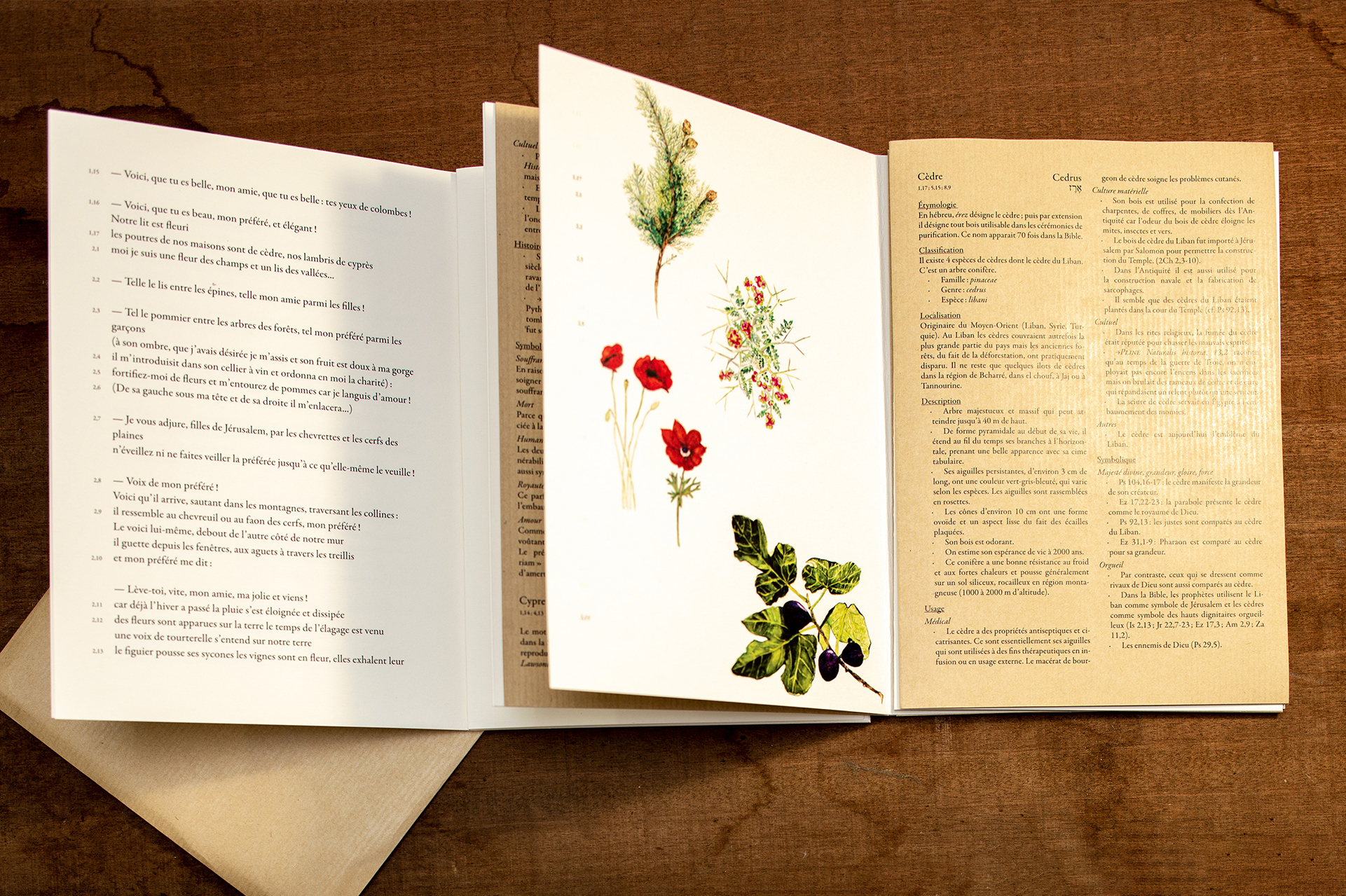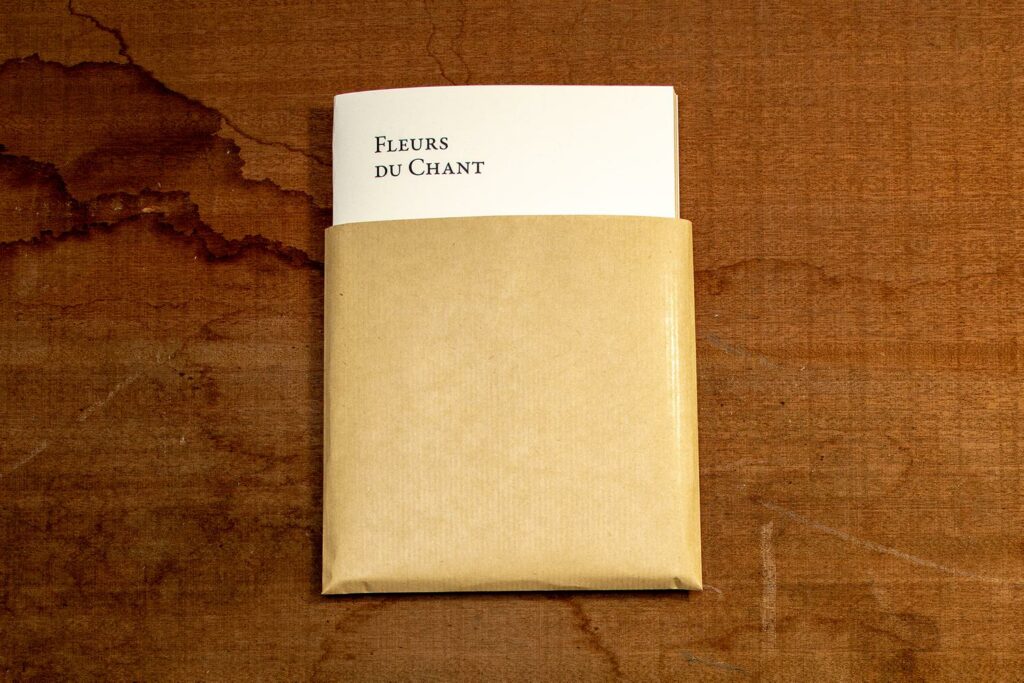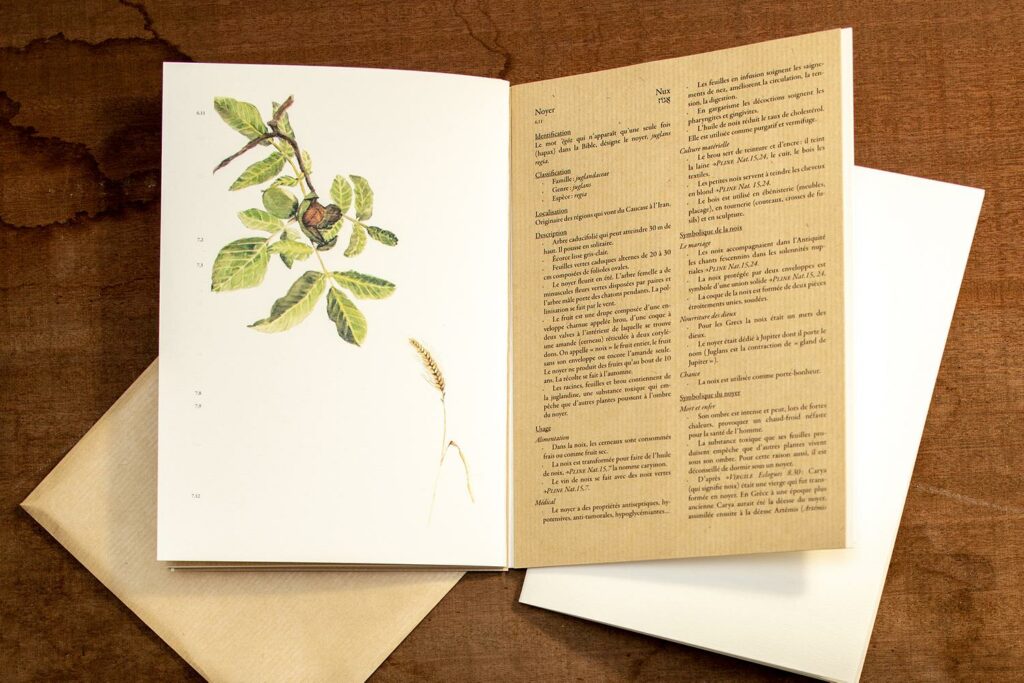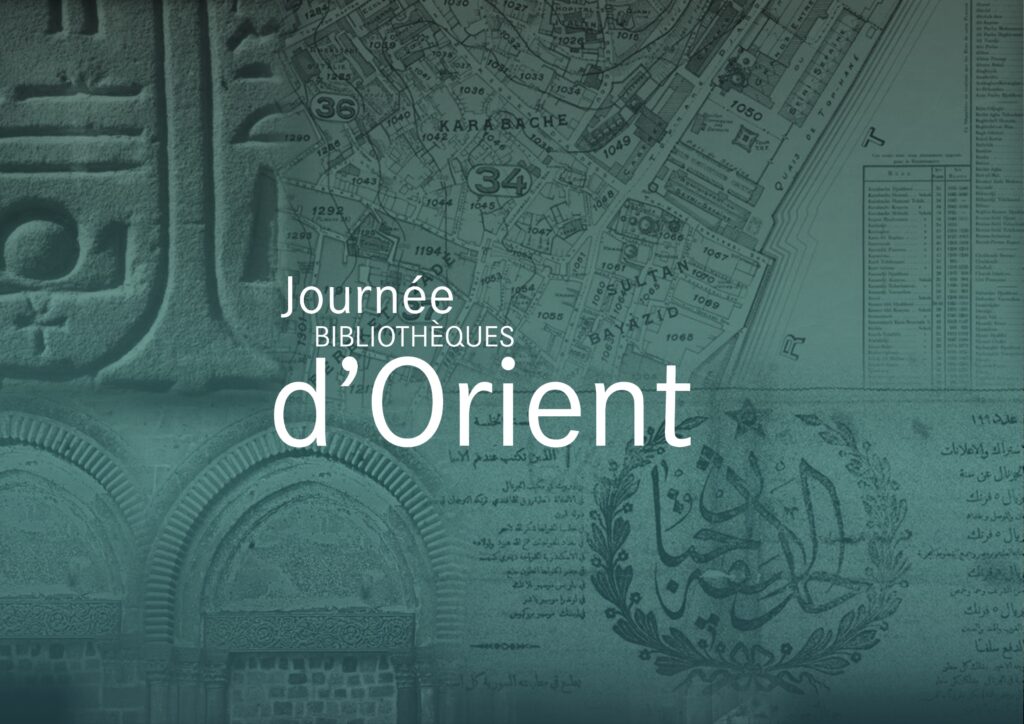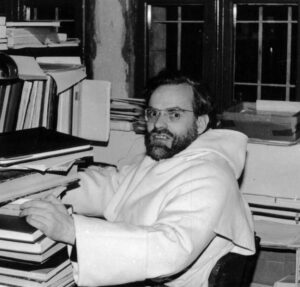CÉLÉBRATION DE LA TRANSLATION DES RELIQUES DE SAINT DOMINIQUE
Vendredi 24 mai, les frères du Couvent Saint-Étienne et les membres de la communauté académique de l’École biblique et archéologique française de Jérusalem ont célébré la fête de la translation des reliques de Saint Dominique. La tradition veut que franciscains et dominicains célèbrent ensemble les fêtes de leurs pères fondateurs. Une communion qui démontre les liens forts qui unissent nos deux communautés en Terre sainte comme ailleurs. Frère Alessandro Coniglio, o.f.m., professeur du Studium Biblicum Franciscanum, a présidé la messe, entouré de nombreux prêtres de différentes communautés. Retrouvez ici son homélie. (Retrouvez ici l’original en anglais.)

” Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous accorde sa paix !
Dans le passage biblique d’Isaïe que nous avons entendu, il y a l’annonce joyeuse de la bonne nouvelle, c’est-à-dire le salut de Sion, la proclamation que Dieu, le Dieu d’Israël, est roi.
Ce salut n’est pas seulement une bonne nouvelle pour Jérusalem, mais c’est aussi un évangile pour toutes les nations, pour toutes les extrémités de la terre. Le prophète annonce son message de bonheur et de réconfort, comme il a commencé à le faire au chapitre 40 : là, il disait נַחֲמוּ נַחֲמוּ עַמִּי ( » Consolez, consolez mon peuple », Is 40 : 1) et ici il dit כִּֽי-נִחַם יְהוָה עַמּוֹ ( » car le Seigneur a consolé son peuple », Is 52 : 9). Ainsi, ce que celui qui apporte de bonnes nouvelles a dit à son peuple une fois, s’est maintenant accompli. Jérusalem a été rachetée, non seulement en espérance, mais en réalité, parce que le salut (יְשׁוּעָה) est venu à elle. Et pas seulement à elle, mais à tous les peuples de la terre.
Au peuple d’Israël désespéré, peut-être en exil, dans l’exil babylonien (selon la datation traditionnelle du texte du Deutéro-Isaïe), le prophète annonce le retour du Seigneur vers son peuple, le retour du Seigneur à Sion, après de nombreuses années où Dieu avait apparemment abandonné la Ville Sainte, comme une épouse divorcée. C’est le signe que le Dieu d’Israël va devenir le Dieu de toutes les nations, car elles vont connaître יְשׁוּעַת אֱלֹהֵינוּ, « le salut de notre Dieu ». Lorsque tous les peuples verront les merveilles du Seigneur, ils reconnaîtront que lui, le Seigneur, est roi, au-dessus de toute la terre (comme nous l’a dit le Psaume responsorial). C’est pourquoi le psaume nous invite aussi à crier notre joie, à chanter et à bénir le saint nom du Seigneur, à proclamer son salut jour après jour. Là encore, comme en Isaïe, le psalmiste utilise le verbe hébreu בשׂר, réjouir d’une bonne nouvelle, annoncer une bonne nouvelle. בַּשְּׂרוּ מִיּוֹם-לְיוֹם יְשׁוּעָתוֹ, « raconter son salut de jour en jour », proclamer toujours sa victoire, son יְשׁוּעָה !
Le monde attendait cette bonne nouvelle à l’époque, mais il semble qu’aujourd’hui encore il soit en quête de salut. La condition des hommes et des femmes n’a pas changé, malgré le ministère prophétique d’Isaïe, malgré la venue de Jésus de Nazareth.
Certes, saint Paul nous dit aujourd’hui que « Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » (1 Tm 2, 3-4). Le salut de Dieu nous est parvenu lorsque Dieu a envoyé le seul médiateur entre lui et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous (1 Tm 2,5-6). Le salut a été accompli par Jésus dans sa mort et sa résurrection, mais nous attendons toujours que ce salut, la victoire de Dieu, puisse atteindre toutes les extrémités de la terre.
L’Évangile de Matthieu nous dit que les attentes des prophètes d’autrefois se sont réalisées en Jésus. Il est le roi, c’est à lui que Dieu le Père a donné toute autorité au ciel et sur la terre. Il est venu apporter le salut et la consolation à tous les cœurs humains.
Ce que Jésus a fait pour notre rançon, il l’a fait une fois pour toutes. Mais maintenant, notre devoir est de répandre l’allégresse de la bonne nouvelle afin que tous les peuples de la terre écoutent la bonne nouvelle et soient sauvés par la miséricorde inépuisable de Dieu. C’est le commandement que Jésus a laissé à ses disciples avant de retourner à la droite de son Père : Allez donc… et enseignez…
Nous sommes tous invités à partager cette bonne nouvelle dans le monde entier, car nous savons que le salut du Seigneur est venu à nous en Jésus de Nazareth. Nous savons, nous avons expérimenté que « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle » (Jean 3,16). Nous sommes témoins que Dieu a donné la vie au monde par la résurrection de son Fils d’entre les morts. Et nous voyons combien le monde a besoin de cette rédemption !
Ici, dans le lieu même où le Verbe de Dieu s’est fait chair pour nous, nous voyons combien de signes de mort nous entourent : la guerre, la violence, l’échec tragique de la communication de chacun avec son voisin… Et si nous élargissons notre regard, notre vue, juste un peu au-delà de la frontière de la Terre Sainte, nous voyons à nouveau des signes de mort et l’apparente défaite du Rédempteur et de son œuvre de rédemption. Les sociétés sont remplies de haine, des guerres opposent des peuples qui vivaient autrefois côte à côte, les frontières sont devenues non pas des signes légitimes d’identité, mais des marques de conflits non résolus. Et chacun des belligérants a son propre récit, et c’est ainsi que se répandent les « fake news » (souvent des deux côtés !), au lieu de la bonne nouvelle du salut.
A l’époque de notre saint père Dominique (c’était aussi l’époque de saint François), la situation n’était pas meilleure qu’aujourd’hui. L’Europe connaissait des guerres internes et la guerre contre l’ennemi extérieur, l’Islam, et un danger très redoutable menaçait la cohésion interne de la chrétienté : l’hérésie des Cathares. La violence et les erreurs, les offenses à la vie et à la vérité, étaient donc le scénario habituel de l’existence à cette époque, comme c’est le cas aujourd’hui, à bien des égards. Face à ces circonstances, Dominique, membre du canonicat de la cathédrale d’Osma, décida de s’engager dans le défi que représentait la situation historico-religieuse. A la suite de son évêque, Diego de Acebo, Dominique, en voyage au Danemark pour une affaire diplomatique, connut la diffusion de l’hérésie dans le sud de la France et l’inefficacité de la réponse « officielle » de l’Eglise.
Dominique a compris que seule une vie cohérente avec l’Évangile pouvait être une réponse aux questions posées par les hérétiques. Comme le messager du prophète Isaïe (Is 52,7), qui annonce la paix, qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce le salut, comme le psalmiste (Ps 96,3), qui raconte jour après jour le salut du Seigneur, déclare sa gloire parmi les nations et ses merveilles parmi tous les peuples, comme Paul (1 Tm 2 : 7), qui a été nommé héraut et apôtre, maître des païens dans la foi et la vérité, Dominique a ressenti comme un message venant directement de Dieu les paroles de l’Evangile : « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit » (Mt 28, 19-20). Muni de l’Évangile de Matthieu et des Lettres de Paul, qui étaient son pain quotidien selon ses biographes, et priant en tout lieu, levant des mains saintes, sans colère ni dispute (1 Tm 2,8), Dominique commença à prêcher la bonne nouvelle non seulement avec sa bouche, mais aussi avec l’exemple de sa vie. Une vie de pénitence et de prière, une vie de méditation continue de la Parole de Dieu, une vie de fraternité et d’amour mutuel, une vie entièrement engagée pour le royaume de Dieu. Il a ainsi atteint l’objectif de ramener de nombreux hérétiques dans le giron de l’Église mère et d’enflammer à nouveau la société chrétienne avec la flamme de son ardeur, de son zèle, de sa ferveur et de sa piété (et de ceux de ses compagnons).
Huit cents ans plus tard, son charisme est toujours vivant et d’actualité. Les Cathares ne sont plus parmi nous, mais de nouveaux types d’hérésies germent tout autour. Et la substance de beaucoup d’entre elles est la même que celle du catharisme : un refus de la vérité, conservée et transmise dans l’Église au cours des siècles, une nouvelle forme de gnose, c’est-à-dire la tentation de trouver le salut non pas dans le Sacrifice de l’Agneau divin, mais dans mes efforts humains et dans une connaissance secrète et ésotérique.
C’est pourquoi la vie et l’œuvre de saint Dominique continuent à nous parler aujourd’hui. Et pas seulement à vous, mes chers Pères Dominicains, mais à tous les chrétiens qui ont à cœur le bien de l’Eglise et des êtres humains.
Que le Dieu tout-puissant nous accorde, par l’intercession de saint Dominique, la grâce de voir les besoins du monde dans lequel nous vivons et de répondre à ses demandes profondes et souvent inexprimées, comme l’a fait Dominique, en poursuivant toujours la vérité, qui n’est pas simplement une doctrine juste, mais une Personne, l’unique médiateur entre Dieu et l’humanité, le Christ Jésus, lui-même humain, le Fils de Dieu, notre Sauveur, Amen.”
fr. Alessandro Coniglio, OFM